Une journée idéale
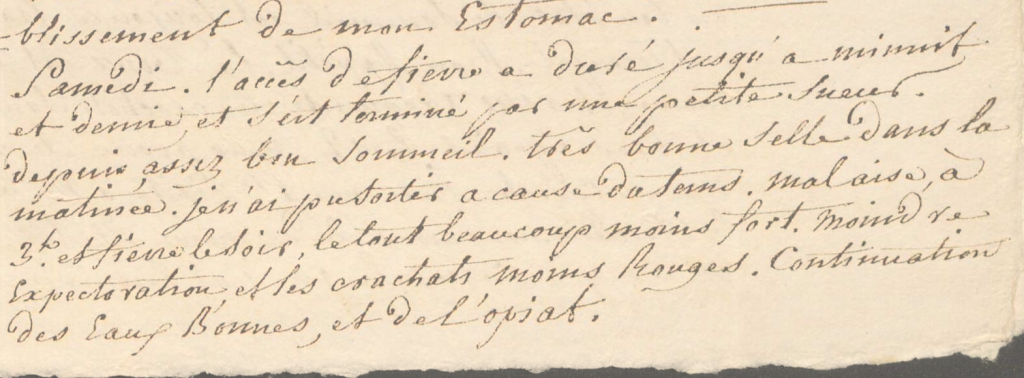
02 juillet 2025
vers 08h15 : J’ouvre les yeux avec difficulté. Mon partenaire vient d’apporter le café que nous partageons chaque matin dans le lit avant son départ au travail. Une fois la porte d’entrée verrouillée, je m’immobilise quelques instants, indécise. Suis-je en capacité d’entamer cette journée ? J’attends que le brouillard s’éclaircisse un peu pour pouvoir analyser les signaux de mon corps. La brume ne se dissipe pas, je peine à rassembler mes pensées. Après tout, c’est peut-être ça, le signal. Je cède à la fatigue lestée et me rallonge. Une poignée de minutes plus tard, j’ai déjà sombré.
10h35 : Je me réveille une seconde fois, probablement grâce aux miaulements de mon chat. En découvrant l’heure, je suis assez heureuse : ces derniers temps, mon corps émerge souvent autour de 11h, 11h30, quand ce n’est pas à 13h45, comme ce jour où l’augmentation du dosage d’un médicament m’a assommée pendant plus de douze heures de sommeil. 10h et demie, c’est bien, ça me laisse un bout de matinée. La brume est toujours là, mais je parviens plus facilement à discerner les signaux corporels. Chaque jour, c’est la loterie : je ne sais jamais quelle douleur sera présente au réveil, et à quelle intensité. Aujourd’hui, le rapport est plutôt dense. Sans surprise, le pic planté dans mon ovaire gauche est bien installé; je sens aussi de légers tiraillements dans la région pelvienne, comme si quelqu’un tentait maladroitement de déplacer mes tissus, de réorganiser mes organes. Là-haut, c’est plus compliqué. Mes nerfs d’Arnold tracent de chaque côté de ma tête un sillon brûlant, qui émerge de la base de mon crâne et court jusqu’au-dessus de mes sourcils. Plus gênant encore, mon nerf trijumeau droit a complètement dérapé ce matin. La partie droite de mon visage est prise de vifs élancements, pénétrant même quelques dents, et j’ai perdu la sensibilité de la zone entre l’œil et la lèvre. Bon, au moins, ça, ça ne fait pas mal. Je me redresse enfin, mobilise ma mâchoire tendue, au coût de quelques crépitements dans ma tempe droite. Difficile de dire qui de la crispation de la mâchoire ou des crises du trijumeau est arrivé le premier, mais il est évident qu’ils se nourrissent l’un l’autre.
vers 11h00 : J’ouvre le tiroir de la desserte et sors les six gélules matinales. J’oublie délibérément un autre traitement, qui favorise ma productivité. Un jour comme celui-ci, son efficacité sur ma concentration sera annihilée par les douleurs et la fatigue, alors autant m’épargner ses effets secondaires. À la place, je prends un anti-douleur assez puissant, espérant qu’il apaise au moins un peu mon visage incandescent. Pendant que mon café chauffe au micro-ondes, je passe aux toilettes. La miction est douloureuse, mais supportable. Je remarque que mon ventre est tendu. On verra bien. Ma tasse à la main, je vais m’installer sur le canapé. J’ai toujours un pic fiché dans l’ovaire et ma sciatique se réveille lentement à droite; de légers picotements parcourent mon aine, ma face me brûle de plus en plus. Je suis obligée de m’allonger, j’ai trop mal assise. Je lance un documentaire sur les dinosaures; tant pis pour l’image, je ferme les yeux, c’est plus confortable.
vers 13h20 : Mon partenaire passe le seuil de la porte. Il s’est arrangé pour télétravailler cet après-midi, afin de pouvoir me conduire à un rendez-vous médical. Le côté droit de ma mâchoire est en feu, j’ai la nausée, mais je me force à manger.
vers 15h45: Nous rentrons, je me sens si fatiguée que je ne parviens pas à garder les yeux ouverts et peine à suivre la conversation entamée par mon partenaire. Et puis, dès que j’ouvre la bouche, mon visage entier crépite sous l’impulsion fébrile de mon trijumeau : je me résigne au silence. Ce sera l’occasion d’écouter un peu de musique. Sur les derniers kilomètres du trajet, j’ai senti venir le début d’une crise d’endométriose : un courant lancinant a parcouru mon bas-ventre quelques minutes. Mauvais signe. Espérant de tout mon cœur que la douleur ne s’emballera pas, je m’allonge sur le canapé, alors que mon partenaire lance un podcast.
vers 17h50 : Je me suis endormie, encore. Je me réveille comateuse. Il est particulièrement difficile de s’extraire de la chape de la fatigue quand cette dernière est solidifiée par les médicaments. J’ai toujours mal à la tête. Je me lève pour reprendre un anti-douleur, accompagné de mon traitement de l’après-midi. En me redressant, les élancements dans mon bas-ventre s’éveillent dans une décharge à l’unisson – je suffoque immédiatement de douleur. Je tente d’aller évacuer quelque chose aux toilettes, quoi que ce soit, même si ça doit m’écraser de douleur, puisque parfois, ça soulage la crise. Rien. Ça va donc durer longtemps. Je m’allonge, une ceinture chauffante sur le bas-ventre malgré la chaleur, et tente de me concentrer sur un nouvel épisode de podcast. La crise me lance, encore et encore. Je sais que je dois rester parfaitement immobile, qu’un seul mouvement peut permettre à la souffrance d’atteindre un paroxysme infernal. Alors j’attends.
vers 19h00 : Mon partenaire a terminé sa journée, la crise s’est adoucie, je ne ressens plus que de légers picotements, comme pour me rappeler que le moindre écart sera sanctionné. Des stries rouges parcourent mon ventre à cause de la chaleur de la ceinture. Ces légères brûlures ne m’inquiètent pas, elles se dissiperont d’ici quelques heures : un faible coût à payer pour rendre un épisode douloureux plus supportable. Nous allons nous balader au bord de la rivière, pour profiter de rayons atténués du soleil et ajouter un peu de mouvement à cette journée somnolente. Ma sciatique me lance pendant que nous marchons, j’ai l’impression que mon utérus a été roué de coups, mais cette parenthèse me fait du bien. En rentrant, alors que mon amoureux prépare le dîner, j’essaie de lire quelques pages d’un roman. Un courant électrique traverse soudainement mon aine. Je soupire – si les traitements aident un peu, au prix d’une grande somnolence, ils ne parviennent pour le moment pas à dompter les douleurs neuropathiques.
vers 22h45 : Après avoir dîné et regardé une série, mon partenaire donne son traitement quotidien au chat et je prends mes médicaments du soir. Dans le lit, alors que ma famille s’assoupit, j’ai du mal à faire abstraction du pic dans mon ovaire, du cisaillement de ma tempe. Je reprends un anti-douleur. Les élancements à divers points de mon corps me tiendront un peu éveillée, mais l’épuisement, amplifié par les douleurs et les traitements, finira par gagner.
Si vous êtes valide, vous considérez probablement ce 2 juillet comme une journée affreuse. Pourtant, à certains égards, il s’agit pour moi d’une journée idéale.
Une journée durant laquelle j’ai eu le temps d’aller à mon rendez-vous. Durant laquelle, lors des crises, j’ai pu m’allonger, prendre le temps de récupérer. Durant laquelle j’ai pu supporter les effets secondaires, vivre avec mes traitements plutôt que les endurer. Et puis, oui, j’ai eu très mal, mais j’ai été épargnée de certains symptômes accablants, comme ces crises digestives durant lesquelles je me vide, à six, sept, huit reprises dans les toilettes, en une matinée à peine.
Évidemment, la grande absente de cette journée, c’est le travail. À raison, puisque je suis en arrêt. Il faut dire que mon état actuel est difficilement conciliable avec la plupart des emplois. Mes pathologies, par le caractère aléatoire de leurs manifestations, imposent une flexibilité quotidienne rarement tolérée au sein du salariat. De même, je ne choisis par la date de la plupart de mes rendez-vous, ni leur heure, qui n’est d’ailleurs pas toujours compatible avec les horaires des trains ou l’emploi du temps de mon partenaire. Mon parcours de soin m’impose de consulter des spécialistes parfois éloignés, et le temps de trajet s’ajoute aux nombreuses heures de consultation hebdomadaires. Si je devais poser une demi-journée de congés pour chaque rendez-vous, voire une journée pour certains déplacements à Paris, je n’aurais assez des 25 jours de congés annuels pour assurer mon suivi. Et ce, sans compter le temps que je dois consumer à récupérer de la fatigue générée par ces rendez-vous. Certes, le télétravail constitue une avancée. Mais il n’empêche pas les crises de douleur quotidiennes, l’épuisement, les conséquences collatérales des traitements sur ma concentration et ma somnolence, qui, additionnés aux heures passées à suivre et organiser mes soins, à contacter des secrétariats, à relancer des médecins, représentent des dizaines d’heures de productivité perdues chaque semaine.
À l’heure actuelle, j’ai le privilège d’occuper pour quelque temps un emploi qui me passionne et m’épanouit intellectuellement et moralement. Idéalement, j’aimerais pouvoir intégrer mon travail au sein de ce quotidien de malade chronique, pouvoir effectuer des sessions ici et là, quand mon état me le permet. Pourtant, aujourd’hui, les priorités sont inversées : on doit insérer notre maladie dans les rares souffles octroyés par le salariat, et tant pis si on ne peut pas consulter nos soignants à un rythme judicieux, et tant pis si on doit continuer à être productif malgré les crises, ne rien pouvoir faire le soir à part somnoler tant la fatigue est grande, subir des crises digestives pendant les rendez-vous professionnels, devoir se retenir au prix d’une souffrance abominable, en attendant avec hâte la délivrance, avoir la nausée de douleur pendant les déplacements, mais tout faire pour ne pas vomir parce que les toilettes publiques sont souvent dégueulasses, et culpabiliser si nos symptômes impactent notre productivité, et paniquer à l’idée de devoir rattraper des heures alors que le rythme est déjà insoutenable, et tant pis si on s’épuise, qu’on finit en burn-out ou en dépression, arrêtée pour quelques semaines, avant de reprendre le même cycle travail/arrêt voué à se répéter tant qu’on ne placera pas le travail dans les interstices de la maladie, et non la maladie dans les interstices du travail. Et ça, c’est quand le travail est réellement compatible avec l’état de santé. Notre société validiste et capitaliste conditionnant notre valeur à notre productivité, il est extrêmement difficile de se détacher de ce schéma, alors que même nos proches lèvent un sourcil suspicieux quand un médecin nous arrête ou que l’AAH nous est accordée.
Valides, vous considérez probablement ma journée du 02 juillet comme un jour catastrophique. A mes yeux, il s’agit au contraire bien d’une journée idéale, m’octroyant le privilège de vivre au rythme de ma maladie, dans un contexte d’errance et d’ignorance de la part de la médecine qui ne sait et ne peut actuellement me soulager – sans devoir me demander comment ces temps improductifs impacteront ma capacité à payer mes factures1, ou comment dissimuler ces heures nulles à mon employeur, ou encore comment les rattraper sans aggraver mon état instable (spoiler : c’est impossible).
Une journée idéale : puisque je dois vraisemblablement souffrir, je peux au moins le faire en paix.
- C’est forcément plus facile dans mon cas : j’ai le privilège d’être en arrêt et de pouvoir encore bénéficier d’indemnités journalières qui me permettent d’éviter de perdre de l’argent par rapport à mes périodes de travail. Si je devais m’appuyer sur mon AAH, dont le montant est inférieur au seuil de pauvreté, ma situation serait bien plus précaire, les regards pleins de soupçons des valides en prime. ↩︎

